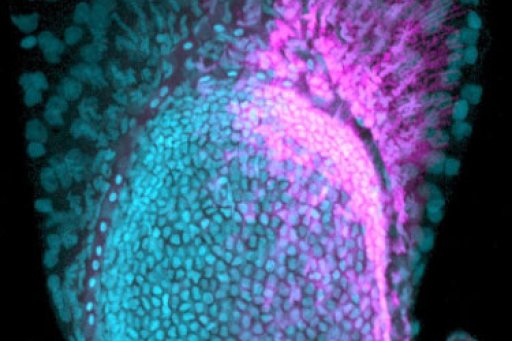Entretien avec Emmanuelle Porcher

Emmanuelle Porcher est directrice depuis 2020 du Centre d'écologie et des sciences de la conservation. Lauréate en 2020 du prix Recherche de la Société française d'écologie et d'évolution, elle est invitée à occuper la chaire annuelle Biodiversité et écosystèmes du Collège de France pour l'année 2023-2024. Elle revient sur les enjeux de recherche auxquels nous nous heurtons face au déclin des pollinisateurs et de tous les écosystèmes dont ils font partie.
Que sait-on aujourd’hui sur le déclin des insectes pollinisateurs ?
Emmanuelle Porcher : Les rares études menées sur le sujet concluent à une disparition de deux tiers à trois quarts de la masse d'insectes en seulement l’espace de quelques décennies. Ces chiffres viennent de deux exemples bien documentés, qui ont attiré l'attention dans le monde de la recherche. En Allemagne, une association naturaliste a utilisé des pièges identiques pendant environ trente ans pour capturer et peser régulièrement la masse d'insectes. Une autre étude au Royaume-Uni a comparé les écrasements d'insectes sur les plaques minéralogiques des voitures entre 2004 et 2021. Cependant, ces études restent à une échelle régionale localisée, et ne permettent pas la caractérisation de ces changements à une échelle mondiale.
L’un des obstacles auxquels nous nous heurtons aujourd’hui est de mettre en évidence ce déclin à une plus large échelle. Pour y parvenir, nous devons utiliser des méthodes standardisées et le faire sur le long terme. Par exemple, en France, bien que les jeux de données des collections du Muséum national d’histoire naturelle soient très précis en termes d’identification des espèces, ils sont issus d'observations collectées de manière hétérogène au fil des années. Leur utilisation pour évaluer le déclin des insectes s'avère donc difficile malgré notre impression de connaissance. Des outils d’analyse statistique existent pour prendre en compte cette hétérogénéité, mais leur efficacité reste encore mal connue. Les synthèses disponibles à l'échelle mondiale divergent donc à cause de l’hétérogénéité des données : certaines signalent un déclin rapide des insectes, d'autres ne détectent aucun problème et certaines mentionnent même une augmentation dans certains environnements.
Dans ce contexte, les sciences participatives peuvent, de prime abord, sembler être un épiphénomène. En réalité, elles changent complètement la dimension de nos recherches dans les sciences naturelles en augmentant considérablement l’échelle des mesures, tout en s’appuyant sur un protocole unique et standardisé. Au lieu de compter uniquement sur un chercheur pour collecter ces données, plusieurs centaines de citoyens font remonter les mêmes informations, assurant ainsi une cohérence dans les données recueillies. Au Muséum national d'histoire naturelle, le programme de sciences participatives Vigie-Nature, en place depuis 1989 pour les oiseaux, se penche en particulier sur l’étude des insectes pollinisateurs, mais aussi celui des plantes pollinisées par ces derniers depuis une quinzaine d’années. En France, nos connaissances acquises sur les changements de la biodiversité ces dernières années proviennent en grande partie des sciences participatives.
On entend beaucoup parler du déclin des insectes. Les plantes, qui dépendent de ces derniers, sont-elles affectées ?
Elles changent elles aussi, même si c’est d’une façon différente. Par exemple, la taille de leurs fleurs a diminué en comparaison d’il y a quelques années. Pour le démontrer, Pierre-Olivier Cheptou, biologiste de l’évolution à Montpellier, a utilisé une approche appelée « l’écologie de la résurrection » : il a cultivé d’anciennes graines de pensées pour ensuite les comparer avec des graines récentes de la même population. Son constat est clair : les plantes ont actuellement des fleurs plus petites par rapport à il y a vingt ans. Cette réduction peut s'expliquer par la diminution de la présence des insectes pollinisateurs : quand il n’y a plus de pollinisateurs à attirer, la sélection naturelle favorise des fleurs plus petites, moins coûteuses à produire.
Il faut comprendre que le principal moteur de la pollinisation, ce sont les insectes. En buvant le nectar des plantes et en mangeant leur pollen, ils trouvent leur source de nourriture et, en transportant les cellules reproductrices entre les plantes, ils garantissent la reproduction de ces dernières. Ce cobénéfice a favorisé, au cours de l’évolution, les plantes ayant des caractéristiques attrayantes pour les pollinisateurs. Par exemple, nous savons que les insectes sont attirés par les couleurs jaunes, bleues et ultraviolettes – d'où la présence de fleurs dans ces teintes. Il arrive même qu'une même espèce de plante, en fonction de la population et du pollinisateur dominant, change de couleur. Par exemple, en Californie, une plante côtière pollinisée par des colibris a des fleurs rouges. Loin de la côte, pollinisée par un papillon, elle présente des fleurs jaunes.
Quand les pollinisateurs deviennent plus rares, les plantes peuvent s’adapter, en changeant leur façon de se reproduire. Une possibilité est de recourir à l’autofécondation, c’est-à-dire la reproduction d’une plante avec elle-même, sans avoir besoin de pollinisateurs. C’est le cas de certaines plantes céréalières comme le blé. Les plantes sauvages autofécondes, d’une part, ont des fleurs plus petites et avec moins de ressources pour les pollinisateurs, et, d’autre part, s’adaptent moins bien aux changements de leur environnement. Nous sommes donc en train de rentrer dans une spirale infernale : il y a de moins en moins de plantes avec de grandes fleurs attirantes et nourrissantes pour les pollinisateurs, ce qui contribue à faire diminuer les populations et à favoriser l’évolution des plantes vers des fleurs encore plus petites et plus autofécondes. Et à terme, celles-ci ne vont pas très bien s'adapter aux variations de l’environnement, par exemple les changements du climat. Il y a donc un risque de voir disparaître un grand nombre d’espèces de plantes.
Quelles conséquences ces transformations ont-elles sur la pollinisation et, plus largement, sur la production agricole ?
Il est probable que la pollinisation soit de moins en moins efficace, mais nous manquons de mesures sur le long terme pour le prouver. C'est précisément l'un des domaines sur lesquels je travaille. Néanmoins, certaines études suggèrent que les rendements des espèces de plantes cultivées, qui dépendent fortement des pollinisateurs, ont diminué ces dernières décennies. Prenons l'exemple des amandiers : la quantité d'amandes produites par hectare diminue dans le monde en raison d'une pollinisation moins efficace. Cependant, la demande mondiale de ce produit reste constante voire augmente, ce qui pousse les cultivateurs à planter des surfaces plus importantes. Il existe même aujourd'hui des entreprises proposant des machines à polliniser ! Ces machines, sous forme de gros tracteurs, pulvérisent du pollen dans les champs. Ce cas des amandiers n'est pas unique. En Bourgogne, les producteurs de liqueur de cassis rencontrent de sérieux problèmes de production. L’écologue Marie-Charlotte Anstett a démontré que l'introduction de nombreux bourdons autour des plants de cassis multiplie par deux voire quatre la production de cassis, permettant aux agriculteurs de générer jusqu'à 15 000 euros de bénéfices supplémentaires par hectare.
Le déclin des insectes et celui du potentiel de la pollinisation ont également un impact sur notre alimentation. Un tiers du volume total de la production agricole et une proportion importante des vitamines essentielles à notre alimentation dépendent des pollinisateurs. Par exemple, 98 % de la production en vitamine C d'origine naturelle provient des plantes, telles que les agrumes, qui requièrent des insectes pollinisateurs.
Quelles solutions peut-on envisager pour mieux protéger les plantes, les pollinisateurs et, avec eux, notre agriculture ?
De façon générale, il faut laisser plus de place au vivant sauvage et à sa diversité. Cela passe bien sûr par un renforcement des espaces naturels protégés, mais aussi par des changements qui permettent aux espèces sauvages de cohabiter avec les humains et leurs activités.
Concernant l'agriculture, jusqu'à présent, la tendance était d'opter pour des champs comprenant uniquement l'espèce cultivée en utilisant des pesticides pour lutter contre les mauvaises herbes et les espèces dites « ravageurs des cultures ». Une solution possible pour éviter leur recours est de diversifier les aménagements en réintroduisant des haies, des petits bois, des mares et des prairies permanentes. En ce moment, par exemple dans le nord de la France, les agriculteurs ne peuvent pas se passer des pesticides, car il n'y a plus d'éléments naturels dans ces paysages agricoles qui permettent d’abriter des prédateurs naturels pour contrôler les ravageurs. Des propositions sont faites pour rendre compatible le retour de ces éléments naturels dans les paysages agricoles avec l’utilisation de machines. Certains imaginent des configurations avec des champs allongés et juste assez d'espace pour faire passer une moissonneuse-batteuse et des haies de chaque côté afin de conserver des rendements élevés en réduisant, voire en abandonnant les pesticides. Ce n’est pas un pur fantasme : des scénarios à l’échelle européenne ont montré que recourir à l’agroécologie serait viable pour notre agriculture. Concernant l'impact sur les espèces sauvages, les études actuelles laissent entrevoir des résultats positifs. Par exemple, dans des champs en agriculture biologique, sans pesticides ni engrais de synthèse, il y a 50 % d'individus en plus et 25 % à 30 % de diversité d'espèces sauvages supplémentaires.
Les champs ne sont pas les seuls espaces sur lesquels nous devons agir si nous voulons préserver la biodiversité. Les espaces urbains doivent être, eux aussi, aménagés en conséquence. Certaines initiatives telles que l'installation de ruches d'abeilles domestiques en ville ont été entreprises. Cela reste une bonne idée en soi, cependant ces abeilles ne trouvent pas toujours une alimentation suffisante dans les plantes ornementales des villes. Ces plantes ont souvent été modifiées par la sélection humaine et ne sont pas toujours riches en ressources. Certaines études ont également montré qu'une forte densité de ruches peut entraîner une compétition entre abeilles et pollinisateurs sauvages, privant les derniers de ressources alimentaires : il est donc important de renforcer la diversité en plantes sauvages y compris au cœur des villes.
Sur le plan collectif, nous devrons revoir nos normes en matière d'aménagement des espaces urbains. Par exemple, des plantes mal aimées comme les orties, souvent écartées des espaces verts, peuvent être bénéfiques pour de nombreux chenilles et papillons. Le lierre, fleurissant en automne lorsque les autres ressources se raréfient, peut être cultivé pour soutenir les abeilles, leur évitant d'être nourries en hiver si elles ont stocké suffisamment de miel provenant du lierre autour de leurs ruches.
Pensez-vous que la biodiversité soit suffisamment prise au sérieux dans les politiques actuelles ?
Étant donné les problématiques actuelles, il est nécessaire de dépasser l'image traditionnelle de l'interaction entre les plantes et les pollinisateurs. Les fleurs et les papillons, c’est mignon, oui. Mais il est crucial de comprendre que c'est un système complexe qui sert de fondations au monde dans lequel nous vivons : nous commençons seulement à en saisir les rouages et la complexité totale échappe encore à notre compréhension. Cela a des implications directes pour nous, les humains.
Il est possible que ce que nous considérons comme insignifiant soit en réalité très important et qu'à un certain seuil, ce système subisse une transformation radicale, avec des répercussions non seulement sur nos ressources alimentaires, mais également sur la qualité de notre environnement. En ce qui concerne la crise de la biodiversité, nous n'avons peut-être pas encore pris la pleine mesure du problème.
Propos recueillis par Emmanuelle Picaud