Entretien avec Denis Duboule
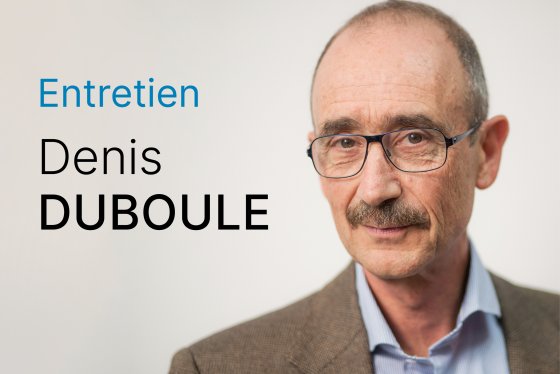
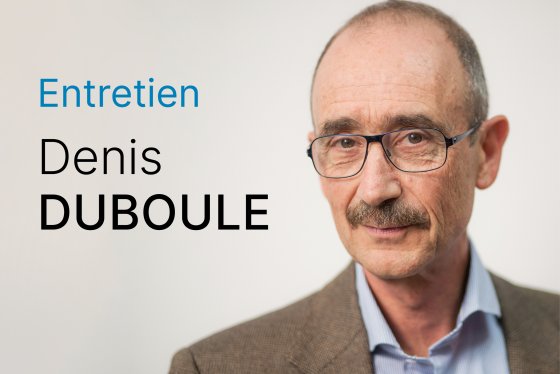
Spécialiste en génétique moléculaire et biologie développementale, Denis Duboule s’intéresse tout particulièrement aux mécanismes de régulation génétique qui régissent l’expression des gènes et le développement embryonnaire.
Professeur invité sur la chaire internationale Évolution des génomes et développement depuis 2017, il devient titulaire en 2022 de la chaire Évolution du développement et des génomes.
Comment en êtes-vous arrivé à vous intéresser au domaine de la biologie moléculaire ?
Denis Duboule : Ayant grandi à la campagne, j'ai toujours aimé la nature et les animaux. Lors de mes études de biologie, je me suis d’abord tourné vers les plantes et les champignons, parce que j'ai un goût pour les classifications – la biologie à l’ancienne. Puis, petit à petit, j'en suis arrivé à l'embryologie qui, pourtant, ne m’attirait pas vraiment à l'université, car tout y semblait compliqué. Quand on s'y intéresse de plus près, cependant, presque par obligation d'examen, on s'aperçoit que c’est une discipline d'une richesse conceptuelle et historique inépuisable. Après mon doctorat, je suis allé à Strasbourg chez le Pr Pierre Chambon, qui a ensuite enseigné au Collège de France. Au bout de quelques mois, il a reçu un manuscrit inédit, écrit par un chercheur de Bâle, Walter Gehring, qui avait fait une découverte incroyable relative aux gènes du développement chez la mouche drosophile. Pierre Chambon était persuadé que ces gènes et leurs fonctions existaient aussi chez les vertébrés, alors il m'a proposé de créer un groupe sur ce sujet. Je n'avais pas une très bonne idée de ce dont il s'agissait, néanmoins, j'étais intrigué, et nous avons donc commencé à travailler avec ces gènes dans un environnement scientifique extraordinaire. Il faut bien comprendre que les quinze dernières années du siècle passé, la fête était permanente en biologie du développement et en génétique. Chaque année, de nouveaux résultats incroyables tombaient, jusqu'au séquençage des génomes au passage du millénaire. Je ne sous-entends pas que la période actuelle n'est pas aussi riche, et ne me confonds pas en nostalgie. Mais il y a eu un tournant, une rencontre entre deux mondes : la biologie du développement – une science avant tout expérimentale, presque de la cuisine avec ses recettes manuelles – et la génétique, qui est d’une approche plus intellectuelle, plus abstraite. Deux états d'esprit d’apparence opposés, qui se sont rejoints grâce à la biologie moléculaire. C’est là qu’on a commencé à comprendre que des gènes contrôlent le développement des embryons.
Comment expliquer les années de circonspection qui ont suivi la découverte de ce mécanisme chez la drosophile ?
Quand le premier gène Hox de vertébré – issu d'une grenouille – ressemblant à ceux de la mouche est apparu, il devint clair que les animaux partageaient des gènes similaires. Pourtant, il fallut encore quelques années pour comprendre que l’organisation générale de ce réseau génétique essentiel pour fabriquer le corps était conservée entre les vertébrés et les invertébrés – que les mêmes règles fondamentales étaient à l’œuvre. Cela ne faisait que préfigurer l’analyse des génomes à la fin du siècle passé, qui montra que, si des différences claires existaient entre les génomes d’espèces distinctes, le nombre de gènes et la façon dont ils sont régulés étaient très similaires entre les espèces. Nous portons en nous l’histoire des animaux. Le prix Nobel de médecine de 1965, le biologiste français François Jacob, le disait déjà dans les années 1970. À l'époque, on pensait que les éléphants avaient une trompe, car ils possédaient un gène de la trompe. Cette conception était entretenue par une vision biaisée de l’évolution et de la génétique qui associait un gène à une caractéristique propre. Mais cela ne fonctionne pas comme ça. Alors, si nous avons les mêmes gènes que l'éléphant, pourquoi n'avons-nous pas de trompe ? C'est un renversement de la question qui nous a conduits à nous demander : comment se fait-il que les animaux soient si différents les uns des autres, alors qu’ils partagent tellement de leur ADN ? Un champ de recherche incroyable s’est ouvert à cette époque, toujours en chantier.

Dans ce contexte, comment un chercheur acteur de ce changement de paradigme parvient-il à se projeter dans la suite de ses travaux ?
Tout chercheur a tendance à penser que ses résultats sont extraordinaires ; en réalité, ce n'est pas forcément le cas. À l'échelle de l'histoire de la vie, c'est un hoquet. Il faut que des individus extérieurs à cette science s'emparent d’elle – des historiens et des épistémologues qui seront en mesure de mettre en évidence le degré d’intérêt de la recherche à un moment donné. Personnellement, je pense que ces quinze années ont beaucoup impacté la théorie de l'évolution. Cela a relativisé la position de Darwin sur la variation des systèmes biologiques qui, à l’évidence, ne se fait pas de façon entièrement aléatoire. En tant qu’humains, nous pensions à cette époque avoir les meilleurs bras, les meilleurs yeux, le meilleur sens du goût... alors qu’en réalité, nous sommes plutôt nuls sur tous ces plans. Mais, la somme de ces éléments, elle, est extrêmement performante. Dans les années 2000, à la fin du séquençage du génome humain, les spécialistes – sachant que la mouche avait 15 000 gènes – prévoyaient qu'on en recenserait entre 120 000 et 130 000 chez les humains. C’est vous dire l'arrogance que nous avions en tant qu'espèce. Et puis – soufflet ! – à peine plus de 20 000 gènes dans notre génome. Un journaliste suisse m’avait appelé pour me demander si je n’étais pas trop déçu par ce nombre... cela montre bien la surprise que cela a provoquée. Aujourd'hui, on sait qu'il est plus simple, d’un point de vue évolutif, d'avoir un gène capable de faire plusieurs choses différentes plutôt que d'avoir autant de gènes que de fonctions.

Avec votre laboratoire, vous avez développé les outils de biologie moléculaire TAMERE et STRING. Que vous ont-ils permis d’accomplir ?
La découverte de la recombinaison homologue dans les années 1990, récompensée par le prix Nobel de physiologie, avait révolutionné le domaine. Elle permettait de détruire des gènes et de voir l'effet que cela engendrait. À cette même époque, nous avons été les premiers à utiliser ces méthodes, non pas pour étudier la fonction des gènes, mais leur régulation – un sujet qui fait partie de la tradition française, puisqu'il remonte à l’Institut Pasteur avec Monod et Jacob. Nous avons développé ces outils génétiques d’ingénierie chromosomique parce que nous voulions connaître l’importance de la position d’un gène sur son chromosome. Comment ces gènes sont-ils contrôlés ? Pourquoi leur expression démarre-t-elle à un moment précis et s’arrête-t-elle à un autre ? En recherche, quand vous faites quelque chose de nouveau, la première publication est assez simple, car c'est inédit. Après, quand vous souhaitez développer un même sujet en allant plus loin, cela devient beaucoup plus compliqué puisque l’effet d’annonce est atténué. Nous avons eu de la chance, grâce à ces technologies, de réussir à garder une visibilité (donc du financement) pendant trente ans, car peu de monde travaillait sur ce sujet qui demandait une logistique génétique très lourde.
Vous avez collaboré avec Steve Gaunt, avec qui vous proposez en 1988 que les clusters de gènes Hox chez les vertébrés sont soumis à une colinéarité spatiale. Quel impact cette découverte a-t-elle eu sur la discipline ?
La colinéarité spatiale, qui veut que le temps et l'endroit d’activation des gènes dépendent de la position des gènes dans leur groupe chromosomique, est un phénomène presque unique à ces fameux gènes Hox. Malgré cette singularité, les résultats de ces travaux nous ont entraînés vers des phénomènes mis en œuvre de façon beaucoup plus large. Auparavant, le gène était tout puissant et représentait vraiment l’unité génétique de base. Aujourd’hui, on voit que le gène est souvent d’une nature assez générique et que ce sont tous les éléments de régulation proches de lui qui comptent, ceux-ci pouvant être distribués sur de longues distances, dans des « paysages de régulation ». Le paradigme s’est donc inversé. Sorti de son contexte, s'il n'y a rien autour de lui, le gène ne vaut pas grand-chose. Aussi, étudier la mouche est très intéressant, car son développement est rapide et l’on peut observer la succession des générations en un laps de temps réduit. Ce type de développement n'est applicable à presque aucun autre animal et pourtant la mouche nous a fourni la plupart des bases des connaissances dont nous disposons sur le développement humain. En étudiant un trait très adapté, on peut dégager des principes très fondamentaux. C’est le principe de l’organisme modèle.
En tant que contributeur majeur à cette discipline depuis plusieurs décennies, quelle est votre perception du statut actuel et de la direction que prend la génomique développementale ?
Il y a un débat très intéressant sur l’avenir de cette discipline. Certains pensent qu'il n'y a plus rien de nouveau à découvrir et que la jeune génération fait de la production de données sans trop réfléchir. Avant, il y avait une recherche par hypothèse – on posait une grande question et l’on se demandait par quelle méthode l’aborder. De nos jours, les méthodologies sont très puissantes et beaucoup de laboratoires produisent des données, qu’ils mettent à disposition de la communauté et examinent par la suite. Parmi ceux de ma génération, quelques-uns pensent que c'est du travail de bourrin, mais je ne suis pas d'accord. La seule façon de faire de la bonne recherche, c'est d’être honnête et précis. Et je suis persuadé que cette approche sera aussi productive que l’ancienne méthode qui, finalement, est assez arrogante, car elle sous-entend que les humains ont la capacité de poser les bonnes questions et d’y répondre. Mais qui peut le prétendre ? L’idée de pouvoir créer de novo des génomes, ayant peut-être des capacités inédites et pouvant nous aider à maîtriser certains des problèmes que nous allons rencontrer, me semble extraordinaire. On peut déjà le faire à l'échelle d'une bactérie, et l’on pourra bientôt l’envisager avec des animaux plus complexes. En biologie, il n’y a que peu d’impossibilités théoriques, seulement des limitations technologiques qui, les unes après les autres, sont surmontées. En 1985, quand on avait bien travaillé, on lisait 30 paires de bases par jour pour séquencer un morceau d’ADN. À présent, on peut séquencer plusieurs génomes entiers, soit 3,5 x 109 paires de bases, par jour.

L’élargissement de nos connaissances vis-à-vis de la génomique du développement s’accompagne parfois d’une méfiance du grand public à l’égard des possibilités d’édition génétique. Dans quelle mesure ce problème occupe-t-il l’esprit des acteurs de cette science ?
J'ai beaucoup investi dans la communication scientifique en général, pas seulement sur nos travaux. C'est d'ailleurs ce que permet de faire le Collège de France, dans un contexte scientifique précis et actuel. Ces questions sociétales et éthiques sont dans l'air depuis très longtemps : la différence, c'est que les gens commencent à être sensibles à ces questions quand les technologies permettent de les mettre concrètement en œuvre. Le chercheur ne doit pas baser sa recherche sur des critères éthiques, mais sur la seule volonté de dégager des vérités pour comprendre le monde qui nous entoure. En revanche, lorsque l'application de ces connaissances entre dans le domaine public, les problèmes se posent. Chez nos voisins suisses où il existe un système de démocratie directe, ces questions sont souvent soumises au vote populaire. Toutefois, cela soulève l’énorme problème de la qualité et de la dissémination de l’information. Les gens doivent être suffisamment informés pour prendre une décision en connaissance de cause. Mais comment s’y prendre ? C'est là que réside le défi posé par ces développements technologiques.
De 2017 à 2022, vous avez été professeur invité sur une chaire internationale du Collège de France. Qu’avez-vous tiré de cette expérience, jusqu’à présent ?
Le Collège de France est une institution extraordinaire, qui n'existe nulle part ailleurs. Quand j'en parle à des collègues américains ou anglais, ils me disent qu'ils ont la même chose, avec des étudiants. Alors, je leur explique qu'on ne donne pas cours exclusivement à des étudiants, mais au grand public. Ils me rétorquent : « Quel genre de public ? Comment est-il sélectionné ? Combien paye-t-il ? Sont-ils diplômés ? » Ils sont interloqués, quand je précise que n'importe qui peut venir, que c’est gratuit, et que ce n'est pas de la vulgarisation, mais de la science actuelle expliquée par ceux qui la font. C'est un concept unique que je trouve formidable, avec une grande accessibilité. Chaque année, nous devons réaliser un nouveau cours, et tout est mis à disposition sur le site web du Collège, ce qui fait que je reçois parfois des messages de pays lointains, d’inconnus me demandant une précision particulière sur tel ou tel cours. Concrètement, le Collège de France a eu de nombreux impacts sur ma vie professionnelle. Pour mes cours, il m’est arrivé de choisir des thèmes pour lesquels j’étais modérément informé. C'est alors, avant tout, une source de culture personnelle incroyable. Par exemple, après six mois de recherches et de lectures, j'ai créé et donné un cours sur les organoïdes, ce qui m’a ensuite permis d’écrire des demandes de subvention cohérentes et renseignées pour une recherche sur ce même sujet. Mais ma joie d’être au Collège de France, c’est surtout l'ouverture sur les collègues de tous horizons, brillants et chaleureux, qui vous extraient de votre laboratoire et vous offrent une vue de l’extérieur. Vous avez donné votre cours, vous êtes fatigué, alors vous allez tendre l’oreille, capter une phrase, une idée, puis vous allez manger sur la place de la Sorbonne. Là, vous avez des idées qui vous viennent, des projets, des espoirs, parce que c'est une démarche inspirante. Après, retournant à mon laboratoire de l’EPFL à Lausanne, avec plein d’énergie, j'ai parfois de la peine à y croire.
Propos recueillis par William Rowe-Pirra
La Fondation du Collège de France a apporté son soutien à l’installation et à l’équipement des laboratoires du Pr Denis Duboule.