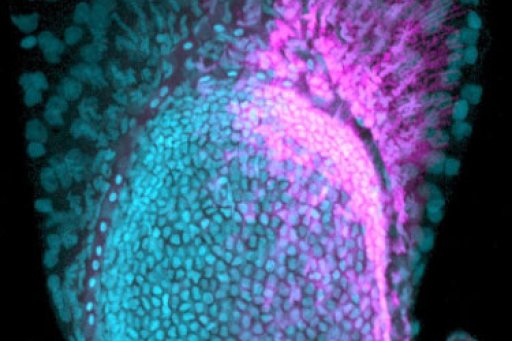Franck Courchamp est directeur de recherche au CNRS. Il dirige à l’université Paris-Saclay une équipe de recherche sur la dynamique de la biodiversité et les impacts des activités humaines sur les écosystèmes et les espèces. Il s'est spécialisé dans l'étude des espèces exotiques envahissantes, c'est-à-dire celles introduites dans un milieu hors de leur aire de distribution naturelle et dont l'intégration finit par altérer tout un écosystème. Un terrain de recherche qui prend de plus en plus d'ampleur à l'heure du réchauffement climatique et dont les répercussions sur l'économie et les sociétés restent encore sous-évaluées.
Il est invité à occuper pour l’année 2024-2025 la chaire Biodiversité et écosystèmes, qui bénéficie du soutien de la Fondation Jean-François de Clermont-Tonnerre.
Vulgarisateur hors pair, Franck Courchamp est l’auteur de plus de deux cent trente publications internationales et l’un des scientifiques les plus cités au monde dans son domaine. L’écologue se passionne depuis quelques années pour un domaine d’étude peu connu du grand public, et pourtant devenu incontournable à l’heure de la mondialisation et du réchauffement climatique : les espèces exotiques envahissantes. Ce terme désigne les espèces (plantes, insectes, mammifères, etc.) qui ont été introduites, involontairement ou non, dans un milieu hors de leur aire de distribution naturelle, et dont l’intégration a fini par altérer tout un écosystème. Ainsi, le moustique tigre en Europe, la fourmi de feu aux États-Unis ou l’iguane commun en Martinique et en Guadeloupe ont la particularité d’avoir été introduits sur un continent dont ils ne sont pas originaires, et d’être parvenus à s’imposer face à la faune locale, jusqu’à décimer les espèces natives.
Un nombre d’espèces largement sous-estimé
« La plupart du temps, les espèces exotiques ne réussissent pas à s’établir dans le milieu où elles sont introduites. Mais certaines y parviennent », décrit Franck Courchamp. Sur trente-sept mille espèces exotiques répertoriées par les scientifiques au niveau mondial, environ trois mille cinq cents d’entre elles sont considérées comme envahissantes. Mais leur nombre est largement sous-estimé. « Le phénomène est en plein essor et les échanges de marchandises n’ont jamais été aussi globalisés. Le Covid n’a été qu’une accalmie temporaire et avec le réchauffement climatique, les aires de distribution de ces espèces vont s’étendre. Nous l’observons déjà avec le moustique tigre en Europe. » La tâche d’inventaire, à peine entamée, est immense. « Il y a des espèces qui sont introduites aujourd’hui et dont nous ne connaîtrons le caractère envahissant que dans plusieurs décennies. Il faut, en moyenne, attendre cinquante ans pour savoir si une espèce exotique est devenue envahissante ou non. »
Quand il pense à son sujet d’étude, l’écologue le décrit comme « vertigineux ». L’expansion des espèces exotiques envahissantes participe, en effet, directement au déclin de la biodiversité au niveau mondial. Et encore, les proportions sont toujours sous-évaluées. « Il y a énormément d’espèces que nous ne connaissons pas et que nous n’avons pas vu arriver. Nous n’avons pas encore pris conscience de cette perte de biodiversité. » La bifurcation de l’écologue vers son sujet d’étude a pourtant d’abord été progressive : « Au départ, je faisais de l’écologie fondamentale. J’étudiais des choses un peu déconnectées de la réalité. Je me contentais de comprendre et d’expliquer des phénomènes, comme un astrophysicien décrit des étoiles. Prendre conscience que nous sommes face à une perte abyssale de notre biodiversité a changé la donne. Pour reprendre la métaphore de l’astrophysicien, si ce dernier voit une supernova proche menaçant notre système solaire, il va tenter de modifier ses recherches pour aider la société à se préparer à ce phénomène. »
Le vrai déclic s’est produit à la fin d’un des cours qu’il a donnés. « Une élève m’a dit : “Monsieur, lorsqu’on sait tout ce que vous savez, comment on fait pour continuer ?” J’ai réalisé que j’étais resté dans mes chiffres. Je n’avais pas pris conscience qu’il y avait une réalité derrière mon sujet d’étude. Les espèces exotiques envahissantes, ce ne sont pas seulement des équations », rappelle le scientifique, dont la motivation reste de « répondre à des questions qui nous paraissent en lien avec notre société ».
Cibler les espèces exotiques envahissantes
Ces dernières années, il s’est ainsi efforcé de mettre au point une méthode qui permettrait de détecter si une espèce exotique sera envahissante ou non, ce qui pourrait aider à leur prévention en amont de son introduction dans un milieu. L’écologue et ses collègues scientifiques ont essayé de dresser le profil type d’une fourmi envahissante, un peu comme un policier de la criminelle : « Les profils des tueurs en série sont obtenus à partir de combinaisons statistiques de caractéristiques psychologiques. Nous avons repris le même principe, mais en modélisant les combinaisons de caractéristiques d’espèces écologiques des fourmis qu’on sait être envahissantes à l’heure actuelle, à savoir dix-neuf espèces sur des milliers. En nous basant sur des caractéristiques comme le type de système social, le moyen de reproduction, le type de fondement de nouvelles colonies ou encore les modes de régime alimentaire, il nous a ainsi été possible d’établir un véritable portrait-robot de la fourmi envahissante type. En s’appuyant sur ces profils, les chercheurs ont ainsi pu identifier de potentielles futures espèces à risque, puis déterminer quelles régions chacune de ces espèces de fourmis pourrait envahir ».
Les travaux de Franck Courchamp ont également eu pour objectif d’estimer les coûts pour la société liés aux dégâts causés par l’introduction d’une nouvelle espèce envahissante. Après cinq années de travail, lui et ses collègues les ont estimés à hauteur de plus de 2 000 milliards de dollars. Pour ce faire, ils ont élaboré une base de données réunissant des milliers de coûts recueillis dans la littérature scientifique, totalisant des milliers de milliards d’euros à l’échelle du globe. Puis, ils ont compilé et analysé les coûts listés dans cette base de données. « Les invasions biologiques n’ont pas uniquement des conséquences sur la biodiversité, elles impactent l’agriculture, la santé humaine, et également les infrastructures et les réseaux électriques et de communications. » En France, leurs coûts économiques y sont évalués entre 1,14 et 10,2 milliards d’euros en seulement vingt-cinq ans. Certaines espèces se placent en championnes des pertes et dégâts, à l’image des moustiques tigres, vecteurs de nombreuses maladies comme la dengue, Zika ou le chikungunya, ou bien l’ambroisie, cette plante aux feuilles vertes hautement allergisante qui provoque de nombreux rhumes des foins et des pertes agricoles.
Un coût important pour la société
À elles seules, ces espèces coûtent près de 40 millions d’euros par an à l’Hexagone. « Malgré l’ampleur impressionnante de ces coûts, ceux-ci sont considérablement sous-estimés. Nous n’avons analysé que la moitié la plus robuste des données disponibles. Si nous avions pris toutes les données, nous aurions eu une estimation totale quatre fois plus élevée. » En outre, ces coûts augmentent de façon exponentielle au fil du temps : le coût moyen triple, en effet, chaque décennie depuis 1970. « Le plus inquiétant, c’est que ce coût global est essentiellement lié aux dégâts et pertes, qui ont coûté dix à cent fois plus que les investissements réalisés pour éviter ou contrôler ces invasions », regrette le chercheur.
Pas question pour autant de se laisser aller à la fatalité. Les solutions existent, assure Franck Courchamp. Le premier levier est d’ordre législatif : interdire les entrées de certaines espèces exotiques dans un nouveau pays est un levier qui a fait ses preuves par le passé. « La Nouvelle-Zélande a réussi à prévenir l’arrivée de la petite fourmi rouge sur son territoire à l’aide de dispositifs de biosécurité aux ports et aux aéroports. Ils ont aussi pu recourir à la vigilance de leurs citoyens pour signaler la présence d’éventuels spécimens sur l’île », détaille le professeur, qui rappelle qu’il existe aujourd’hui des méthodes de détection des spécimens comme l’ADN environnemental ou les sciences participatives, qui permettent de pouvoir agir dès en amont. « Il faut agir vite, dès que le foyer commence à se former, sinon c’est trop tard. » Franck Courchamp milite aussi pour une prévention et une sensibilisation auprès des entreprises importatrices : « Le fardeau de la preuve doit être déplacé, comme nous le faisons depuis des décennies avec les enjeux de pollution environnementale. Cela ne doit plus être aux scientifiques de montrer qu’une espèce est envahissante, mais aux entreprises de démontrer que les espèces qu’elles importent ne sont pas envahissantes ».
Une approche pluridisciplinaire
« Les invasions biologiques, c’est une très bonne façon de montrer la complexité des écosystèmes. Il n’y a pas une réponse toute faite, c’est un ensemble de critères combinés qui vont diriger une dynamique dans un sens ou dans un autre. » Certains chercheurs sont parvenus à toucher du doigt cette complexité, comme Bob Holt, un biomathématicien américain, qui s’intéresse aux interactions entre les espèces. Ce dernier est parvenu à démontrer que dans un milieu donné, un prédateur ne peut pas tuer toutes ses proies, sinon il disparaît. « Il n’y a pas de prédateur qui tue trop, sinon il n’a plus de ressources et il ne peut survivre », explique Franck Courchamp. Bob Holt a travaillé sur les paramètres qui permettent de mettre en place cette théorie. « Il a réussi l’exploit de rendre les mathématiques élégantes à mes yeux, alors que je n’aimais pas particulièrement les maths ! », s’exclame le professeur.
Ou encore Robert May, ancien conseiller scientifique en chef du gouvernement britannique dans les années 1990. « Il faisait aussi des modèles mathématiques sur les virus. Il a démontré qu’un parasite n’éliminera pas toute la population de son hôte, qu’il doit trouver un compromis. Si elles tuent leur hôte, les souches de virus trop virulentes disparaissent avec lui avant d’avoir pu coloniser un nouvel hôte. Elles doivent alors être très contagieuses pour se maintenir dans la population, et être moins virulentes pour ne pas éliminer tous leurs hôtes. Ce scénario catastrophe n’existe tout simplement pas dans la nature ». L’écologue, à son tour, réussit à démontrer que certaines espèces exotiques envahissantes pouvaient avoir un effet complexe et parfois paradoxal dans les milieux qu’elles ont colonisés. Ainsi les chats envahissant certaines îles protègent malgré eux les oiseaux, car ils les défendent de la prolifération d’un prédateur autrement plus redoutable, le rat. Un exemple que Franck Courchamp compte d’ailleurs développer dans son cours au Collège de France. « Et ces complexités et paradoxes augmentent lorsque l’on intègre d’autres approches disciplinaires, comme l’évolution, l’économie ou la sociopsychologie par exemple. »
« Ce qui me fascine dans ce sujet d’étude, c’est qu’à chaque fois que nous rajoutons une discipline, nous ajoutons une couche de complexité. Cette complexité peut faire peur, mais c’est aussi elle qui m’anime », assure Franck Courchamp, qui a pour projet de faire participer plusieurs intervenants de diverses disciplines cette année au Collège de France, allant du spécialiste de l’économie fonctionnelle à l’épidémiologiste, en passant par le philosophe ou encore le biogéographe. « Il n’y a pas une solution, une seule manière de faire, sinon ce serait trop simple », ironise l’écologue, qui reste convaincu de la nécessité d’un dialogue entre les disciplines afin de faire avancer la recherche écologique.
Article d'Emmanuelle Picaud